Bienvenue sur les pages du Ministère fédéral des Affaires étrangères
Le long chemin vers la stabilité et la paix en Afghanistan
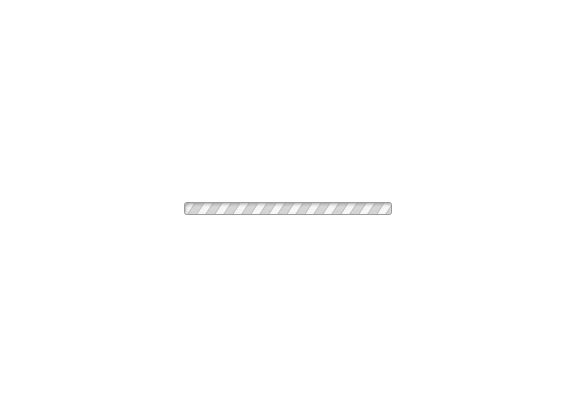
Un soldat de la Bundeswehr dans une rue du camp Marmal à Mazar-e-Charif, © picture alliance / Gregor Fischer/dpa | Gregor Fischer
Aujourd’hui, le conseil des ministres allemand a adopté une décision visant à prolonger la mission de la Bundeswehr en Afghanistan. Cette décision doit désormais être prise par le Bundestag. La mission a également pour but que les pourparlers de paix interafghans se poursuivent.
Cela fait maintenant quatre décennies que la guerre et la violence marquent le quotidien en Afghanistan. Depuis la chute du régime taliban en 2001, il a toutefois été possible de mettre en place des structures efficaces dans de nombreuses parties du pays. L’accès de la population à l’éducation, aux soins de santé, à l’électricité et à l’eau a été nettement amélioré, et le revenu par habitant a plus que triplé. Dans le même temps, on a également observé le développement d’une société civile vivante et d’un paysage médiatique dynamique. Les femmes et les enfants bénéficient en particulier de libertés nouvellement acquises, même s’il subsiste encore de trop grandes disparités entre les droits garantis par la loi et leur application sur le Terrain.
Instaurer la stabilité dans un environnement difficile
Le but est de conserver les progrès accomplis et en même temps de trouver une solution politique stable permettant de mettre fin aux violences persistantes et d’offrir à toutes les Afghanes et les Afghans des perspectives d’avenir. Les pourparlers de paix qui se déroulent actuellement entre les représentants de la République islamique d’Afghanistan et les Talibans constituent un pas important dans cette direction. Ce processus en est encore à ses balbutiements. Afin que des progrès soient réalisés, le soutien de la communauté internationale reste nécessaire. La présence militaire internationale demeure un facteur important à cet égard, puisqu’elle donne aux négociations la marge de manœuvre nécessaire. Les activités de conseil en matière militaire restent elles aussi nécessaires. En dépit des efforts accomplis l’année dernière en matière de renforcement des capacités des forces nationales de défense et de sécurité en Afghanistan, ces dernières ne sont pas encore en mesure de garantir de manière autonome la sécurité dans tout le Pays.
Dans ce contexte, le gouvernement fédéral allemand prévoit dans un premier temps de prolonger le mandat de la Bundeswehr jusqu’au 31 janvier 2022. L’Allemagne doit continuer d’être un partenaire fiable au sein de l’OTAN et aussi vis-à-vis de ses partenaires dans le nord de l’Afghanistan, à l’égard desquels elle assume des responsabilités particulières en tant que nation-cadre. Dans le même temps, la Bundeswehr doit pouvoir réagir de manière appropriée à d’éventuels ajustements de la mission Resolute Support. Ce faisant, la sécurité des soldates et soldats de la Bundeswehr sur place constitue une priorité particulière.
Le long chemin de l’Afghanistan vers la paix
Les pourparlers de paix entre les délégations de la République islamique d’Afghanistan et des Talibans ont commencé le 12 septembre à Doha. En vertu du principe d’un processus de paix mené par et pour les Afghans (« Afghan-led, Afghan-owned »), il appartient aux seuls négociateurs afghans de déterminer le processus de négociation. 21 délégués de chaque partie participent aux négociations, étant précisé que l’équipe de négociation de la République islamique d’Afghanistan comprend quatre femmes. Comme on pouvait s’y attendre au vu de la durée du conflit, les négociations ne se font pas sans heurts et ont déjà été plusieurs fois interrompues, ce qui montre que les délégués des deux équipes de négociation sont confrontés à une tâche difficile : ils doivent parvenir à un accord durable qui mette fin à la violence, pose les jalons de l’ordre politique et sociétal futur et tienne également compte des questions relatives à la réconciliation nationale. Une solution politique durable n’est en effet possible que si l’ensemble des acteurs politiques pertinents, la société civile et tous les groupes ethniques sont associés à ce processus.
Le gouvernement fédéral soutient activement le processus de paix interafghan à Doha en mettant à disposition des compétences techniques et spécialisées. Dans ce contexte, il est essentiel de préserver les progrès réalisés au cours des dernières années, en particulier dans le domaine des droits de l’homme et des droits des femmes. Le ministre fédéral des Affaires étrangères Heiko Maas a souligné les points suivants lors de l’ouverture des pourparlers de paix :
Les Afghanes et les Afghans souhaitent la fin de la violence et un cessez-le-feu durable. Ils veulent vivre dans la dignité et la paix. Et ils veulent voir l’État de droit et les droits de l’homme respectés – non en théorie mais en pratique. La poursuite du soutien international dépend du respect de ces droits fondamentaux et de l’ordre constitutionnel de l’Afghanistan.
Soutien de l’Allemagne à l’Afghanistan
Ces deux dernières décennies, la communauté internationale a déployé des efforts exceptionnels pour appuyer l’Afghanistan. L’Allemagne aussi s’est engagée considérablement sur le plan militaire et civil. Ce faisant, l’engagement continu de la Bundeswehr constitue un élément important pour instaurer la stabilité. La poursuite de cet engagement doit permettre d’éviter qu’un retrait trop rapide des troupes ne compromette les progrès accomplis ces dernières années.
L’engagement allemand a principalement pour but de créer des structures étatiques, des bonnes conditions de vie ainsi que des perspectives d’avenir pour la population afghane. L’Allemagne forme, conseille et soutient les forces de défense et de sécurité afghanes, mais elle fournit également de l’aide humanitaire et réalise des projets de coopération au développement. Dans ce contexte, l’Allemagne est le deuxième donateur bilatéral de prestations de soutien civil pour la stabilisation et la coopération au développement (environ 430 millions d’euros par an).