Bienvenue sur les pages du Ministère fédéral des Affaires étrangères
Accord de Schengen
Historique et développement de l’Accord de Schengen
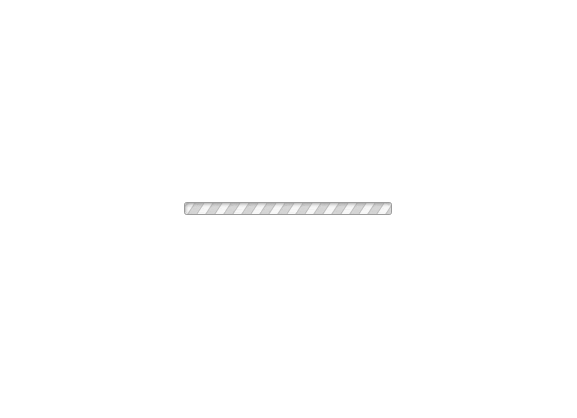
Le 14 juin 1985, la République fédérale d’Allemagne, la France, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas signaient à Schengen (ville luxembourgeoise aux frontières de l’Allemagne et de la France) un accord relatif à la suppression graduelle des contrôles de personnes aux frontières intérieures entre les Parties contractantes.
Le 19 juin 1990 était signée la Convention d’application de l’Accord de Schengen (Convention de Schengen). Celle-ci prévoit des mesures compensatoires qui visent à garantir, suite à la suppression des contrôles aux frontières intérieures, un espace unique de sécurité et de justice. Elles portent notamment sur
- l’harmonisation des dispositions concernant l’entrée et les séjours de courte durée d’étrangers dans « l’espace Schengen » (visa Schengen uniforme) ;
- l’asile (détermination de l’État partie responsable du traitement de la demande d’asile) ;
- les mesures de lutte contre le trafic de drogue transfrontalier ;
- la coopération policière et
- la coopération des États Schengen dans le domaine judiciaire.
La Convention de Schengen est officiellement entrée en vigueur le 1er septembre 1993 mais c’est seulement le 26 mars 1995 que ses dispositions ont été appliquées dans la pratique et qu’elle a été « mise en vigueur », c’est-à-dire après que les conditions techniques et juridiques nécessaires ont été créées (ex : création de bases de données et des autorités nécessaires pour assurer la protection des données à caractère personnel).
À compter du 1er mai 1999, la coopération de Schengen, uniquement fondée à l’origine sur le droit international, a été intégrée dans l’Union européenne en vertu du protocole Schengen annexé au Traité d’Amsterdam du 2 octobre 1997.
Les compétences en matière d’acquis de Schengen (l’Accord de Schengen et les réglementations qui en découlent) et son développement ont été en grande partie transférées à la Communauté européenne.
Appartenir à l’espace Schengen présente de nombreux avantages pour les États membres de l’Union européenne. La suppression des contrôles aux frontières intérieures de l’Union est non seulement synonyme d’une plus grande liberté pour les citoyennes et les citoyens, mais aussi d’une sécurité améliorée. Cette suppression des contrôles aux frontières intérieures est compensée par des contrôles plus efficaces aux frontières extérieures de l’espace Schengen ainsi que par d’autres mesures aux frontières intérieures, comme une surveillance mobile des régions frontalières et une plus forte coordination des activités de police. Les ressortissants allemands restent cependant tenus d’être en possession d’un passeport en cours de validité ou d’un titre tenant lieu de passeport (ex : carte d’identité (provisoire), titre de voyage tenant lieu de passeport) pour sortir d’Allemagne ou entrer en Allemagne. Le non-respect de cette obligation fait encourir une amende administrative pouvant aller jusqu’à 5 000 euros.
Depuis 1985, l’espace Schengen a été agrandi à plusieurs reprises.
L’Italie a signé la convention le 27 novembre 1990, l’Espagne et le Portugal le 25 juin 1991, la Grèce le 6 novembre 1992, l’Autriche le 28 avril 1995, le Danemark, la Finlande et la Suède ainsi que l’Islande et la Norvège (ces deux derniers n’étant pas membres de l’UE) le 19 décembre 1996. La Suisse, qui ne fait pas non plus partie de l’UE, a signé l’accord en 2004. La République tchèque, l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie ont adhéré le 21 décembre 2007. Le Liechtenstein (non-membre de l’UE) a rejoint l’espace Schengen en 2011.
Les pays membres de l’UE que sont la Bulgarie, Chypre, la Roumanie et la Croatie ne sont pas encore membres à part entière de l’espace Schengen ; les contrôles aux frontières entre ces pays et l’espace Schengen sont maintenus (voir ci-dessous concernant la position du Royaume-Uni et de l’Irlande).
Réglementation des visas
Éléments de la réglementation
- Les ressortissants des États Schengen (voir ci-dessous) peuvent franchir les frontières intérieures de l’espace Schengen sans être soumis au contrôle des personnes. En cas de menace contre l’ordre public ou la sécurité nationale, les États peuvent cependant effectuer des contrôles aux frontières intérieures pour un laps de temps limité. Malgré l’accord, les ressortissants allemands restent tenus d’être en possession d’un passeport en cours de validité ou d’un titre tenant lieu de passeport (ex : carte d’identité) pour sortir du territoire fédéral ou y entrer.
- Les titulaires d’un visa de court séjour délivré par un État Schengen et non limité dans sa validité géographique (visa Schengen de la catégorie C) sont autorisés, dans le cadre de la validité de leur visa, à séjourner et à se déplacer librement dans l’ensemble du territoire des États Schengen. Ils ne sont pas non plus soumis à des contrôles au passage des frontières intérieures. Les visas de transit aéroportuaire (catégorie A) autorisent uniquement à séjourner dans les zones internationales de transit des aéroports et non à entrer dans l’espace Schengen.
- Les ressortissants d’États tiers titulaires d’un titre de séjour national d’un État Schengen sont autorisés, dans le cadre de la validité de ce titre de séjour et pour une durée maximale de 90 jours par période de 180 jours, à séjourner également dans le territoire des autres États Schengen.Cette réglementation s’applique aussi aux titulaires d’un visa « national » délivré par un État Schengen (visa de catégorie D).
- L’harmonisation des politiques de visa des États parties (liste commune des États tiers dont les ressortissants sont soumis ou non à l’obligation de visa).
- Des contrôles aux frontières extérieures soumis à des critères uniformes.
- L’accès des États parties au Système d’Information Schengen (SIS) qui regroupe des données concernant les personnes et les objets dans l’ensemble de l’espace Schengen, notamment à des fins de recherches.
- Une coopération policière et judiciaire étroite.
- La lutte commune contre la criminalité en matière de stupéfiants.
- Des règles de compétence pour l’exécution des procédures d’asile (remplacées entre-temps par le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003, dénommé « Règlement Dublin II »).
États membres
Les États suivants appliquent les dispositions de l’acquis de Schengen dans leur intégralité (« pays appliquant l’acquis de Schengen dans son intégralité ») :
Tableau
Pays | Suppression des contrôles aux frontières |
Allemagne, Belgique, Espagne, France, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal | 26 mars 1995 |
Italie | 26 mars 1997 |
Autriche | 1er décembre 1997 |
Grèce | 26 mars 2000 |
Danemark, Finlande, Islande, Norvège, Suède | 25 mars 2001 |
Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Malte, Pologne, République tchèque, Slovaquie, Slovénie | 21 décembre 2007 |
Suisse | 12 décembre 2008 (frontières terrestres), 29 mars 2009 (frontières aériennes) |
Liechtenstein | 19 décembre 2011 |
Suite à l’entière suppression des contrôles aux frontières intérieures, le titulaire d’un visa commun peut séjourner pendant la durée de validité de son visa, sans dépasser toutefois 90 jours sur une période de six mois, dans les pays susmentionnés qui appliquent la Convention d’application de l’Accord de Schengen.
Acquis de Schengen (en allemand)
Suisse
Les Suisses ayant approuvé en juin 2005 l’Accord d’association à l’espace Schengen avec l’UE et la CE, la Suisse applique l’Accord de Schengen depuis le 12 décembre 2008. La suppression des contrôles de personnes aux frontières aériennes a suivi le 29 mars 2009.
Danemark, Irlande et Royaume-Uni
Au sein de l’Union européenne, des régimes dérogatoires sont prévus pour le Danemark, l’Irlande et le Royaume-Uni.
Le Danemark applique l’acquis de Schengen dans son intégralité, mais il a fait valoir, lors de la signature de l’Accord de Schengen, une réserve concernant la mise en œuvre et l’application de décisions futures sur la base de l’Accord. Il décide au cas par cas s’il se joint au développement de l’acquis de Schengen sur la base du droit international et s’il souhaite appliquer en tant que droit national le droit communautaire formé sans son implication. Le Danemark est cependant tenu à certaines mesures dans le domaine de la politique commune de délivrance de visas.
L’Irlande et le Royaume-Uni ne sont pas parties à l’Accord de Schengen. Ils peuvent appliquer l’acquis de Schengen intégralement ou partiellement avec l’approbation du Conseil de l’UE et participer au développement de ce dernier. Ils ne délivrent pas de visas Schengen. Les deux pays n’appliquent qu’en partie l’Accord de Schengen. Le Conseil des ministres de l’UE a approuvé une demande correspondante de ces pays concernant le renforcement de la coopération de la police et de la justice en matière pénale ainsi que dans la lutte contre la drogue et dans le Système d’Information Schengen (SIS). Il n’y a cependant pas eu de suppression des contrôles aux frontières.
Islande et Norvège
L’Islande et la Norvège, qui ne sont pas membres de l’Union européenne, appliquent l’acquis de Schengen dans son intégralité sur la base d’un accord d’association avec l’Union européenne en date du 18 mai 1999.
Les deux pays sont membres (de même que le Danemark, la Finlande et la Suède) de l’Union nordique des passeports, qui a supprimé les contrôles à ses frontières communes. Le Conseil de l’Union européenne a décidé le 1er décembre 2000 de faire entrer en vigueur l’acquis de Schengen dans les cinq pays de l’Union nordique des passeports. L’acquis de Schengen s’y applique depuis dans son intégralité. Les dispositions relatives au Système d’Information Schengen (SIS) sont déjà en vigueur dans ces pays depuis le 1er janvier 2000.
Dans les domaines de l’acquis de Schengen qui s’appliquent à l’Islande et la Norvège, les relations entre ces deux pays, d’une part, et l’Irlande et le Royaume-Uni, d’autre part, sont fixées dans une convention qui a reçu l’aval du Conseil le 28 juin 1999.
L’Islande et la Norvège, en tant que pays ne faisant pas partie de l’Union européenne, sont associées dans la pratique par des comités mixtes qui se réunissent parallèlement aux groupes de travail du Conseil de l’Union européenne. À ces réunions participent des représentants des gouvernements des États membres de l’Union européenne, de la Commission et des gouvernements des États tiers. L’Islande et la Norvège prennent ainsi part aux discussions sur le développement de l’acquis de Schengen, mais non aux votes.
Andorre et Saint-Marin
Andorre n’a pas signé explicitement la Convention de Schengen. Il n’existe cependant pas de contrôles aux frontières avec l’Espagne et la France voisines. Saint-Marin n’a pas explicitement signé la Convention de Schengen, mais il n’y a pas de contrôles à la frontière avec l’Italie, son seul voisin.
Bulgarie, Roumanie, Chypre et Croatie
Bien qu’étant membres à part entière de l’Union européenne, la Bulgarie et la Roumanie (adhésion le 1er janvier 2007), Chypre (adhésion le 1er mai 2004) et la Croatie (adhésion le 1er juillet 2013) n’appliquent encore que partiellement l’acquis de Schengen. Ces pays ne délivrent donc pas encore de visa Schengen uniforme.
Pour pouvoir reprendre l’acquis de Schengen dans son intégralité, il faut remplir certaines conditions, dont la mise en œuvre du système développé de signalement des personnes ou des objets (Système d’Information Schengen de deuxième génération – SIS II) et l’aboutissement d’une procédure d’évaluation au cours de laquelle sont examinées les conditions nécessaires à l’application de l’acquis de Schengen dans son intégralité. Ce n’est qu’après que la décision politique peut être prise d’appliquer la convention de Schengen dans son intégralité et que les contrôles aux frontières intérieures peuvent être supprimés.
Législation relative à l’Accord de Schengen (liste non exhaustive)
- Accord de Schengen – Accord du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française, relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (Bulletin interministériel fédéral – GMBl. 1986, p. 79 et suiv.)
- Convention de Schengen – Convention d’application du 19 juin 1990 de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française, relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (Journal officiel fédéral – BGBl. II 1993, p. 1013 et suiv.)
- Loi du 15 juillet 1993 sur la Convention de Schengen du 19 juin 1990 relative à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (BGBl. II 1993, p. 1010 et suiv.)
- Publication de l’entrée en vigueur de la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française, relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (BGBl. II 1994, p. 631 et suiv.)
- Traité d’Amsterdam en date du 2 octobre 1997 (BGBl. 1998 II, p. 386)
- Code frontières Schengen (Règlement CE n° 562/2006 du 15 mars 2006), en vigueur depuis le 13 octobre 2006